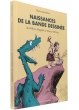- -5%
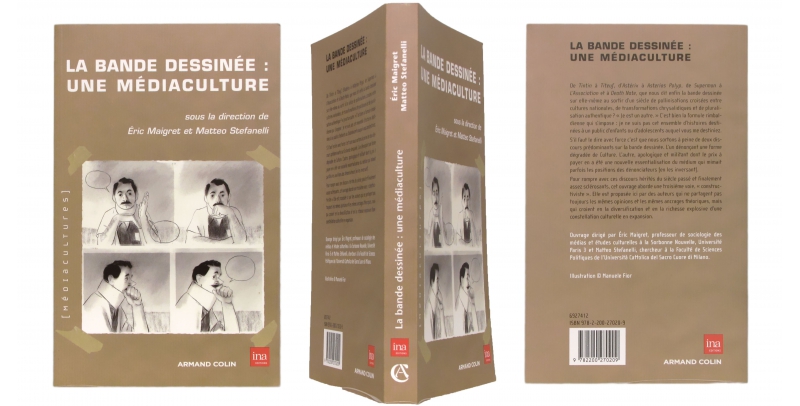
Pays : France, Paris
Editeur : Armand Collin
Collection : INA Éditions
Année d'édition : 2012
Première édition : 2012
271 pages
14 x 22,5 cm - 410 gr
Langue : Français
ISBN : 9782200270209
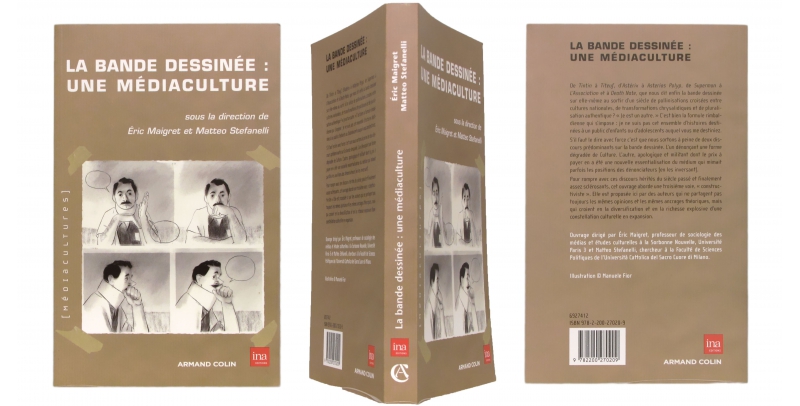


Sous des dehors respectables, l'objet est fragile et nous conseillons de la manipuler délicatement. Le pelliculage de la couverture n'est pas de très bonne facture, les pages sont seulement collées, sans brochage, et on sent qu'une pliure trop rude de la couverture pourrait les détacher. C'est bien dommage, d'autant plus que le pavé de texte s'engage un peu loin dans la marge intérieure. Du coup, il faut incliner légèrement le livre pour atteindre du regard le début des lignes, si l'on ne veut pas prendre le risque de casser le dos. Peu d'illustrations, mais elles sont légendées. Nombreuses notes, et une bibliographie pour chacun des chapitres. Table des matières détaillée, mais pas d'index.
Notule de lecture de Manuel Hirtz :
Un recueil d’articles riche et stimulant. En voici le menu.
Introduction par Éric Maigret, sociologue.
Matteo Stefanelli livre une synthèse du discours sur la bande dessinée des origines aux années 2000 où les adversaires américains des comics, Wertham et Legman, sont décrits comme « ayant des faiblesses théoriques et méthodologiques » et où Bande dessinée et culture d’Evelyne Sullerot est curieusement qualifié de pamphlet. L’auteur tente ensuite une cartographie des recherches sur la bande dessinée, axée essentiellement sur les auteurs universitaires qu’en bon camarade il semble tous trouver pleins de promesses.
Éric Maigret réexamine les analyses sur la légitimation de la bande dessinée de Boltanski et de Groensteen. L’auteur postule que nous serions dans un régime culturel post-légitime, et il fait l’hypothèse que la bande dessinée serait le colonisé de la culture, dans une époque qui — c’est le paradoxe — est post-coloniale. Il file alors cette métaphore des post-colonial studies, avant de conclure dans une envolée socialisante et lyrique. On comprend dès lors pourquoi il s’en prend avec virulence à la sémiologie de la bande dessinée, considérée comme « essentialisante » et par conséquent, dans un référentiel multiculturaliste, comme désespérante.
Thierry Smolderen explicite la méthodologie empirique qui a abouti à son remarquable Naissances de la bande dessinée et revient sur l’ambiguïté du cas Töpffer.
Xavier Guilbert fait le point sur le marché de la bande dessinée en France, au Japon et aux États-Unis dans un texte clair et mesuré.
Gilles Ciment fait un tableau sans fard de la bande dessinée comme pratique culturelle aujourd’hui.
Olivier Vanhée fait un bon article sociologique sur la réception du manga en France, enquête à l’appui.
Philippe Marion tente une définition de la poétique en bande dessinée avant de revenir à la problématique de la graphiation à propos du Photographe de Guibert et de Tintin au cinéma, version Spielberg.
Jan Baetens propose un très bon article sur les graphic novels.
Matteo Stefanelli se propose finalement de reposer les rapports entre cinéma et bande dessinée. Il admet que d’un point de vue théorique c’est sans espoir puis part dans des réflexions qui mériteraient d’être développées.
Ian Gordon fait le point sur les adaptations de bandes dessinées au cinéma.
Conclusion de Matteo Stefanelli où l’auteur fait feu de tout bois en proposant des pistes de recherches et des hypothèses, parfois extrêmement intéressantes, parfois très aventurées.
Source : The Adamantine - (c) Harry Morgan et Manuel Hirtz
Les auteurs p. 3
Introduction : Un tournant constructiviste p. 5
PARTIE 1 : POLITIQUE ET HISTOIREUn siècle de recherches sur la bande dessinée (Matteo Stefanelli) p. 17La bande dessinée comme objet théorique. Éléments pour une archéologie des discours sur la BD p. 17
Pour un cartographie des théories : disciplines et paradigmens p. 22
Le cadre des comics studies : approches et domaines de recherche p. 29
Théorie des bandes débordées (Eric Maigret) p. 50Le « langage » de la BD : la domination du modèle linguistique p. 51
Temporalité, séquentialité et langage visuel p. 54
« Le rapport infini » entre l'image et l'écrit p. 58
Flux bande dessinée et analyse de dispositifs p. 62
Pour une socio-histoire des bandes dessinées p. 64
Sur quelques conditions d'apparition p. 66
Histoire de la bande dessinée : questions de méthodologie (Thierry Smolderen) p. 71La flèche du temps p. 71
Multiplicité des groupes concernés et des définitions p. 73
La définition de l'art séquentiel p. 74
Le concept d'art séquentiel comme discriminant historique p. 75
Le creuset de l'illustration humoristique p. 76
Stylisation et diagrammatisation p. 77
Le genre des histoires en images vu à travers le prisme polygraphique p. 81
L'invention de Töpffer p. 82
Conclusion p. 86
PARTIE 2 - PRATIQUES ET PUBLICSTour de marchés (France, Japon, Etats-Unis) (Xavier Guilbert) p. 93Une santé fragile p. 94
La course en avant de la surproduction p. 99
Japan Gross National Cool p. 103
L'approche 360 p. 109
La frontière numérique p. 111
En guise de conclusion p. 114
Annexes : Modèles éditoriaux p. 115
La bande dessinée, pratique culturelle (Gilles Ciment) p. 11Une légitimation très critiquée p 118
L'absence de médiateurs culturels p. 119
Où ranger la bande dessinée dans les pratiques culturelles ? p. 121
La concurrence des nouveaux médias p. 123
Une lecture encore très masculine p. 123
La jeunesse et la bande dessinée p. 125
Pour une étude sur la pratique culturelle de la bande dessinée p. 127
Bande dessinée et postlégitimité (Eric Maigret) p. 149Le vol suspendu de la légitimité culturelle p. 130
Les aléas du régime postlégitime p. 135
La bande dessinée : culture postlégitime p. 13
L'impossible distinction par le roman graphique p. 141
Le positionnement des chercheurs : comment ne plus être légitimiste p. 145
La lecture de manga et ses transformations : enquête sur plusieurs générations de lecteurs en France (Olivier Vanhée)L'appréciation et la connaissancve des mangas en France p. 151
La passion pour le manga dans les trajectoires de lecteurs p. 160
PARTIE 3 - POÉTIQUE ET TRANSMÉDIALITÉEmprise graphique et jeu de l’oie (Philippe Marion) p. 175Une poétique de la bande dessinée ? p. 176
Pour une poétique médiagénique de la BD p. 189
Le roman graphique (Jan Baetens) p. 200Une évolution inévitable ? p. 200
Pour une première définition du roman graphique p. 201
Le roman graphique : une forme d'adaptation littéraire ? p. 205
Le roman graphique « contre » la littérature ? p. 209
Le roman graphique : ni case, ni planche, mais livre p. 212
Du "cinéma-centrisme" dans le champ de la bande dessinée (Matteo Stefanelli) p. 217Pour une analyse des configurations sociales p. 218
Les discours théoriques sur la BD et l'influence du cinéma p. 219
De Luca et la mise en abyme du dispositif de la planche p. 224
L'influence du cinéma dans les pratiques de création et de production des newspaper strips p. 231
Conclusion : la bande dessinée au-delà de son destin cinématographique p. 234
La bande dessinée et le cinéma : des origines au transmédia (Ian Gordon) p. 237Naissance de la bande dessinée : définitions et catégorisations p. 237
Les influences respectives de la bande dessinée et du cinéma : portées et limites p. 239
Des supers-héros en blockbusters p. 240
La bande dessinée au cinéma : une affaire de convergence p. 243
Les emprunts du cinéma, au-delà des super-héros p. 245
Quant aux mangas p. 247
Conclusion : Aux marges d’une ambiguïté médiaculturelle : quatre questions brûlantes pour une théorie culturelle de la bande dessinée (Mario Stefanelli) p. 253Une marginalité artistique p. 254
Des visions immersives p. 257
L'espace feuilleté et l'interface de la planche p. 259
Une modernité liminale p. 262
De Tintin à Titeuf, d’Astérix à Asterios Polyp, de Superman à L’Association et à Death Note, que nous dit enfin la bande dessinée sur elle-même au sortir d’un siècle de pollinisations croisées entre cultures nationales, de transformations chrysalidiques et de pluralisation authentique ? « Je est un autre. » C’est bien la formule rimbaldienne qui s’impose : je ne suis pas cet ensemble d’histoires destinées à un public d'enfants ou d'adolescents auquel vous me destiniez.
S’il faut le dire avec force c’est que nous sortons à peine de deux discours prédominants sur la bande dessinée. L’un dénonçant une forme dégradée de Culture. L’autre, apologique et militant dont le prix à payer en a été une nouvelle essentialisation du médium qui mimait parfois les positions des dénonciateurs (en les inversant).
Pour rompre avec ces discours hérités du siècle passé et finalement assez sclérosants, cet ouvrage aborde une troisième voie, « constructiviste ». Elle est proposée ici par des auteurs qui ne partagent pas toujours les mêmes opinions et les mêmes ancrages théoriques, mais qui croient en la diversification et en la richesse explosive d’une constellation culturelle en expansion.
Ouvrage dirigé par Éric Maigret, professeur de sociologie des médias et études culturelles à la Sorbonne Nouvelle, Université Paris 3 et Matteo Stefanelli, chercheur à la Faculté de Sciences Politiques de l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
 Retour à la page précédente
Retour à la page précédente
Lire aussi