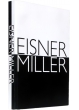- -5%

Homère du XXe siècle
Pays : France, Lyon
Editeur : Les Moutons électriques
Collection : Bibliothèque des mirroirs
Année d'édition : 2013
Première édition : 2013
244 pages
21 x 17 cm - 425 gr
Langue : Français
ISBN : 9782361830755



Si la couverture du Stan Lee n'est pas celle que nous préférons de Sébastien Hayez, elle contribue toutefois, comme pour les autres titres de la collection Bibliothèque des Mirroirs, à bien mettre en valeur l'ouvrage. Celui-ci s'intègre bien dans la collection, dont il respecte tous les caractères saillants : petit format tendant vers le carré, protection par une couverture souple renforcée de profonds rabats, impression monochrome à l'intérieur, à l'exception toutefois des quatre premières pages qui présentent des extraits en couleur de bandes dessinées de l'auteur, texte composé sur deux colonnes, et intelligemment déporté vers la marge extérieure, table des matières abrégée et index. Plus spécifique à ce livre, des illustrations judicieusement choisies et bien légendées (mais pas datées).
Notule de lecture de Harry Morgan et Manuel Hirtz :
Ouvrage consacré au père de la « maison aux idées ».
La première partie de l’ouvrage est un historique nourri à toutes les sources possibles de la carrière du « mage de l’ère Marvel ». Le lecteur attentif et lucide en conclura que Stan Lee fut dans les années 1940 et 1950 un des nombreux soutiers du comic book qui, sous la férule de Martin Goodman, réalisa moult comics books à l’imitation des succès du temps, love comics, funny animal, récits d’horreur dans la veine des EC Comics, etc. Puis Stan Lee fut, grâce à Jack Kirby et Steve Ditko, dans les années 1960, un très grand editor, sous l’égide duquel naquirent les Fantastic Four, Spider-Man, les X-Men, et nombre de personnages aujourd’hui connus de tous. Dans les années 1970, il géra le fonds Marvel bon an mal an. Puis, à partir des années 1980, Lee a produit à la paresseuse des comics, des romans et des produits télévisuels tous plus calamiteux les uns que les autres.
Dans la seconde partie de l’ouvrage, l’auteur revient sur ses pas et reprend les éléments qu’il a jugés périphériques, par exemple Millie the Model, ou The Cat, avant de détailler le travail d’editor et de décortiquer la fameuse méthode de production Marvel.
M. Lainé poursuit son étude de Stan Lee comme editor dans la troisième partie où in fine il analyse le Surfer d’argent, en qui il voit une préfiguration du comic book moderne à visée philosophique. L’auteur accorde une très grande importance au fait que les aventures du héraut cosmique sont faiblement liées à la continuité et de la chronologie de l’univers Marvel, sans que l’on comprenne très bien l’enjeu de la chose, sauf à titre de sujet de conversation de fans.
Dans la quatrième partie, M. Lainé étudie les apparitions de Stan Lee à l’intérieur des bandes dessinées.
Enfin, dans la cinquième et dernière partie, « thèmes et discours », l’auteur cherche le propos général des séries de Stan Lee, mais ne trouve rien de saillant. Éloge de l’individualité et de la responsabilité (« de grands pouvoirs donnent de grandes responsabilités »), méfiance envers le communautarisme, attitude ambivalente vis-à-vis de la science, force est de conclure que les points de vue de Stan Lee sont ceux des Américains de sa génération.
La difficulté principale de l’auteur semble avoir été d’unifier le point de vue du jeune fan qu’il a été, pour qui Stan Lee est un démiurge, créateur d’univers (l’Homère du XXe siècle annoncé dans le sous-titre), et le point de vue de l’historien rassis qu’il est devenu, qui porte un regard plus lucide sur son objet d’étude. M. Lainé signale ainsi comme en passant que « le travail de Stan Lee sur les premiers numéros des Fantastic Four est peut-être plus éditorial que littéraire », mais il n’arrive jamais à conclure clairement sur la position autoriale de Jack Kirby. C’est d’autant plus regrettable que l’importance du travail de l’editor est, elle, bien cernée.
On regrettera la tendance de Jean-Marc Lainé à l’énumération et à la digression.
Source : The Adamantine - (c) Harry Morgan et Manuel Hirtz.
Introduction p. 7
I. REPÈRES BIOGRAPHIQUES p. 11Premiers pas, premières créations p. 11
Dans le giron de Martin Goodman p. 13
Service militaire p. 22
Vie de famille p. 23
Valse des genres p. 26
Ce bon docteur Wertham p. 34
Atlas p. 37
1957, l'année fatidique p. 38
Crise de la quarantaine p. 46
Monster Comics p. 50
Quatre personnages dans le vent p. 55
L'univers Marvel p. 61
Conflits d'ego p. 68
Sortir du comic book p. 72
Vers de nouvelles responsabilités p. 75
Projets d'écriture p. 79
Dans les hautes sphères p. 86
Retour en grâce ? p. 9
II. UNE MÉTHODE p. 97Exploration des genres p. 98
Recycler les concepts p. 108
Vieux personnages p. 109
Scénariste unique, personnages uniques p. 111
Histoire, temps et continuité p. 117
Scénariste ou dialoguiste ? p. 122
Responsable éditorial p. 127
La méthode Marvel p. 130
III. CULTE DE LA PERSONNALITÉ p. 139Lettreurs p. 141
Monsieur Loyal p. 145
« Stan Lee Presents » p. 146
Caisse à savon p. 149
Fan-Clubbing p. 152
Univers partagé p. 156
Histoire des comic books p. 161
L'ombre de Stan Lee p. 168
Inimitable ? p. 169
IV. L'HÉRITAGE p. 171Modèle et référence p. 171
Héros malgrè lui ? p. 171
La figure de l'éditeur p. 178
Cinéma et télévision p. 181
Évolution de la critique p. 183
V. THÈMES ET DISCOURS p. 185Personnages américains p. 185
Duellistes p. 189
Héros solitaires p. 192
Différence et tolérance p. 195
Pas de communautarisme p. 196
Romance et Soap p. 201
La figure féminine p. 205
Responsabilité et pouvoirs p. 208
Le rapport à la science p. 211
« Polymathes » polyvalents p. 214
La peur p. 224
La peur de l'inconnu p. 226
La peur politique p. 226
La peur sociale p. 228
La peur comme moteur p. 230
Conclusion p. 233Remerciements p. 238
Index p. 239
Table des matières p. 243
Bibliographie p. 236
S'il fallait une preuve que le monde des super-héros Marvel est un univers partagé, il conviendrait de citer ce papy chétif aux grandes lunettes de soleil qui, déguisé en vendeur de sandwich, en facteur new-yorkais ou en général de l'armée américaine, hante les adaptation sur grand écran, des X-Men au Avengers. Qui est ce vieillard à l'accent traînant, qui est partout à la fois, qu'on montre du doigt avec un sourire de connivence, et dont on attend l'apparition avec impatience ? Simple. C'est Stan Lee.
Co-créateur du panthéon Marvel dans lequel s'agitent avec le succès que l'on sait les X-Men, Iron -Man, Spider-Man ou les Avengers, Stan Lee est aujourd'hui une figure reconnue de la culture populaire. Ses interviews paraissent dans les magazines télé, les maximes de ses personnages sont citées dans les chroniques radio. Et pourtant, la réputation de Stan Lee a été entachée de nombreuses polémiques.
Qu'en est-il de cet amateur de bons mots et de titres ronflants ? N'est-il qu'un excellent vendeur qui s'est trouvé au bon moment dans la bonne maison d'édition ? Ou demeure-t-il un auteur aux techniques littéraires éprouvées et aux thématiques récurrentes ? L'univers Marvel ne lui doit-il qu'un vernis de modernité, ou bien une réelle identité ?
 Retour à la page précédente
Retour à la page précédente
Lire aussi