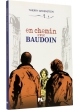- -5%

Pays : France, Montrouge
Editeur : PLG
Collection : Mémoire vive
Année d'édition : 2021
Première édition : 2021
236 pages
16 x 24 cm - 650 gr
Langue : Français
ISBN : 9782917837405



Le titre ne manquera pas d’évoquer l’autobiographie du mangaka Yoshihiro Tatsumi, parue en France en deux volumes sous le nom d'Une vie dans les marges. C’est pourtant dans la collection « Mémoire vive » (qui en l’occurrence porte bien son nom) de la maison PLG que ces souvenirs sont parus, adoptant dès lors les caractères formels de la collection à laquelle l’auteur, Thierry Groensteen, avait déjà donné un titre. Il s’agit donc d’un in-octavo à couverture souple, consolidée de profonds rabats. La maquette, due comme il se doit à Luc Duthil, voit le texte abondant courir tout au long des 236 pages (une longueur peu habituelle dans cette collection) sur une seule colonne, dans un petit corps, néanmoins lisible, qui produit des pages denses. Des illustrations de la main de François Ayrolles viennent rompre pour quelques instants le fil du propos, ainsi que deux reproductions de deux planches dessinées par l’auteur du livre. Un cahier photo regroupant une grosse trentaine de clichés est installé au centre du livre, qui dispose encore d’une bibliographie listant les nombreux ouvrages écrits ou dirigés par Thierry Groensteen, ainsi que d’un index. La première de couverture a été composée à partir d’une image d’Emmanuel Guibert, tandis que l’image de la quatrième est à nouveau de François Ayrolles. Plus discrètement à l’intérieur, le point final est un portrait de la plume de Julie Doucet. Beaux hommages par des grands artistes à une figure incontournable des études sur la bande dessinée.
Notule de Harry Morgan et Manuel Hirtz :
Empruntant tour à tour aux genres de l'autobiographie, du récit d'entreprise, des mémoires d'intellectuel, Thierry Groensteen retrace les étapes de sa vie et de sa carrière, en s’interdisant les règlements de compte mais pas l'humour. Compte tenu de l’ubiquité de notre auteur, l'ouvrage constitue un précieux témoignage sur le monde de la bande dessinée des années 1980 à nos jours, l'accent étant naturellement mis au premier chef sur le discours critique relatif au neuvième art, sur sa patrimonialisation et sur son enseignement, mais aussi sur l'édition puisque Thierry Groensteen est également éditeur.
L'auteur a, chose rare, une vision réflexive de sa propre œuvre et il témoigne d'une modestie qui ne doit rien à la coquetterie. Ainsi, il aborde des éléments que tout auteur normalement constitué passerait sous silence presque par instinct (un album raté, une médiocre traduction, qui dessert l’ouvrage traduit).
Curieusement, l'impression qui se dégage à la lecture des souvenirs de l'auteur, à qui nul ne déniera qu'il est le premier théoricien de langue française du médium, est celle de la précarité du statut d'intellectuel au tournant du XXIe siècle. L'ouvrage serait mieux titré, Une vie entre les cases ou Une vie hors des cases, tant il apparaît que l'auteur, apparemment au cœur des institutions du neuvième art, puisqu'il tient la chronique du Monde, qu’il réalise la principale revue d'étude, et ceci deux fois de suite (avec Les Cahiers de la bande dessinée, puis avec Neuvième Art), qu'il dirige le musée de la bande dessinée, qu'il enseigne la bande dessinée à l'École de l'image d'Angoulême, n'est à sa place nulle part. Les Cahiers de la bande dessinée sont inexplicablement édités par un Jacques Glénat qui dénonce avec furie l'« intellectualisme » de la revue. La carrière de Groensteen dans les institutions angoumoisines de la bande dessinée, qui devraient en toute logique lui faire un pont d’or, est une série de faux départs. Si Groensteen est, et de très loin, le théoricien le plus cité dans les travaux des universitaires et des chercheurs, ni l'université ni le CNRS n'ont jugé utile de le recruter. Et même pour ce qui est des publications, où la bibliographie de notre théoricien se passe de commentaire, Groensteen nous livre une anecdote très drôle et très révélatrice. La directrice de collection qui accepte le manuscrit de Système de la bande dessinée aux PUF dans la collection Formes sémiotiques, explique à l'auteur à quel point l'ouvrage est naïf, s'étonne elle-même qu'on publie un manuscrit reçu par la poste et – c’est le point crucial – fait comprendre à l'auteur qu'il ne fait pas partie de la bande, en l'occurrence celles des disciples d'Algirdas Julien Greimas.
Les aléas de l’existence, l’inertie des hommes et des institutions n'empêchent nullement que notre théoricien peut, à la fin de l’ouvrage, observer le résultat de ses efforts. La recherche sur la bande dessinée a désormais une histoire.
Source : The Adamantine - (c) PLG, Harry Morgan et Manuel Hirtz
Introduction p. 6
Chapitre 1. D’où je viens p. 8
Chapitre 2. Belge, mais pas trop p. 15
Chapitre 3. Un vernis de culture p. 21
Chapitre 4. Du fanzinat au journalisme p. 30
Chapitre 5. Le dessin et l’écriture p. 40
Chapitre 6. Le temps de la spécialisation p. 50
Chapitre 7. Cinq ans à la tête des ‘Cahiers’ p. 62
Chapitre 8. De Cerise à Oubapo p. 83
Chapitre 9. Angoulême ou la BD au musée p. 94
Chapitre 10. Transmettre p. 114
Portfolio. Une vie en images p. 121
Chapitre 11. L’université, la recherche et mo p. 129
Chapitre 12. Mon histoire avec Töpffer p. 140
Chapitre 13. Du côté de l’édition p. 150
Chapitre 14. Retour à la Cité p. 168
Chapitre 15. Appelez-moi commissaire p. 179
Chapitre 16. Mon histoire avec Hergé p. 187
Chapitre17. Commis voyageur du 9e art p. 197
Chapitre 18. La passion du récit p. 209
Chapitre 19. Pour conclure p. 218
Bibliographie p. 224
Index p. 228
Quarante ans après la publication de son premier livre (une monographie sur Tardi), Thierry Groensteen se retourne sur un parcours qui l’a vu endosser successivement les fonctions de critique, essayiste, animateur de revues, directeur de musée, enseignant, commissaire d’expositions, conférencier, éditeur, scénariste occasionnel. Il relate notamment ses débuts dans le fanzinat, l’aventure des Cahiers de la bande dessinée qui posèrent les bases de la critique savante, les colloques de Cerisy, la création de l’Oubapo, la redécouverte de Töpffer, les liens souvent compliqués du chercheur indépendant avec l’institution universitaire. Son récit alerte et riche en anecdotes constitue un témoignage unique qui éclaire des pans entiers de l’histoire moderne de la bande dessinée et le processus qui a conduit à sa reconnaissance comme objet culturel et comme art.
 Retour à la page précédente
Retour à la page précédente
Lire aussi