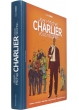- -5%

Années 1920-1960



L'ouvrage est conforme aux standards de la collection Esprit BD de la maison Karthala. Les cahiers sont collés sur un dos carré, derrière une couverture souple. Imprimé en noir et blanc dans un format in-octavo, le livre est illustré à la façon des autres titres de la collection : les reproductions, souvent des cases isolées, sont placées sur une page qui leur est dévolue. N'occupant pas toute la surface de la page, elles sont cernées d'un large blanc tournant. Une légende datée les accompagne. Le texte circule de page en page dans une composition qui n'est guère attrayante : le choix d'un espacement interparagraphe ou le maintien de l'alinéa en début de paragraphe après un titre sont contestables. Ce sont des pratiques plus fréquentes en bureautique qu'en typographie. Le livre s'achève sur une bibliographie précédant la table des matières. Pas d'index.
Introduction p. 5
.
CHAPITRE 1 - CATHOLICISME p. 15
. Sur les fonts baptismaux p. 16
. Une BD « chrétienne » ? p. 21
. Un catholicisme de conquête p. 28
. Divergences et évolutions p. 37
. Sexisme ? p. 46
.
CHAPITRE 2 - ANTICOMMUNISME p. 55
. Au début était Tintin p. 56
. Nouvelles alliances, nouveaux héros p. 62
. Un devoir de réserve ? p. 69
. Petits belges dans la lignée du Petit Vingtième p. 78
.
CHAPITRE 3 - NATIONALISME p. 89
. Un matrice maureassienne ? p. 91
. Ruptures p. 97
. ... et réminiscences p. 101
. Un patriotisme « franco-belge » ? p. 105
.
CHAPITRE 4 - COLONIALISME p. 121
. Faire connaître « notre Congor » p. 122
. Vers une exaltation de la domination française p. 129
. Des clichés au service d'un projet « éthique » p.136
. Paternalisme versus fraternité p. 144
. Des exploits « postcoloniaux » ? p. 149
.
CHAPITRE 5 - MONARCHISME p. 155
. Des héros prompts à sauver des monarques p. 156
. L'écho de la « question royale » ? p. 160
. Contre la tyrannie ! p. 164
. La République oubliée ? p. 170
.
Conclusion p. 181
Études et témoignages p. 188
La BD belge des années 1920-1960 a bénéficié d’un fort impact social sur un temps étendu. Elle a notamment offert au genre nombre de « classiques », constamment réédités, comme les exploits de Tintin ou ceux de Spirou. Il s’agit d’une littérature pour les jeunes, et même avant tout pour les jeunes garçons, qui privilégie l’esprit d’aventure ou l’humour. Mais les éditeurs et les auteurs n’étaient pas coupés de leur époque, et un certain discours politique transparaît entre les cases et les bulles.
La BD belge d’expression française est ainsi marquée par sa naissance au sein de milieux catholiques conservateurs, voire maurrassiens. Durant l’entre-deux-guerres, on trouve dans maints récits des clichés anticommunistes, antiaméricains, antisémites ou colonialistes. Après 1945, les cartes sont largement rebattues. Dans le cadre des nouvelles alliances, des héros pilotes de chasse américains font leur apparition, tandis que les vieux clichés à connotation raciste tendent à disparaître. Mais on peut aussi raisonner en termes de permanences, et noter qu’un monarchisme plus ou moins diffus imprègne la production belge, depuis les années 1930 jusqu’aux années 1960.
Cet ouvrage n’entend ni exalter un prétendu « âge d’or », ni dénoncer des errements idéologiques, mais permettre aux amateurs de relire la BD belge sous un angle plus politique, et fournir aux enseignants des pistes pour mieux intégrer le 9e art au sein de leurs pratiques pédagogiques.
Philippe Delisle est professeur d’Histoire contemporaine à l’Université Lyon 3. Il étudie depuis plusieurs années le discours catholique et colonialiste de la BD « franco-belge ».
 Retour à la page précédente
Retour à la page précédente
Lire aussi